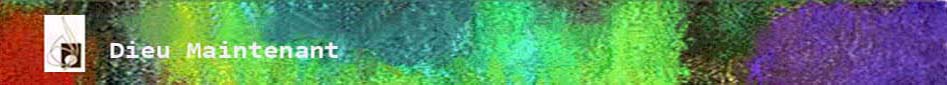

Pédophilie dans l'Eglise :
c’est tout le système clérical qu’il faut déconstruire
Danièle Hervieu-Léger
Le scandale de la pédophilie ne résume pas toute la crise de l’Église catholique, affirme la sociologue Danièle Hervieu-Léger. Cette crise plonge ses racines dans des choix auxquels l’Eglise est arrimée depuis le XIXe siècle, et avec lesquels elle s’étiole depuis des décennies. Si elle ne se décide pas, rapidement, à regarder en face la gravité du mal qui la ronge et à faire preuve d’audace, l’institution pourrait bien mourir avec ses idées — et laisser ses fidèles en plan.
Danièle Hervieu-Léger est directrice d'études honoraire à l’École des hautes études en sciences sociales. Cet article a été publié dans "Télérama" le 12 novembre 2018.
Les sous-titre sont de la rédaction de "Dieu maintenant".

Autonomie des citoyens et contestation de l’emprise normative de l’Église sur la société.
Quelle est l’intensité de la crise que traverse l’Église catholique ?
Danièle Hervieu-Léger : Elle est gravissime. D’une ampleur comparable, selon moi, à celle qui a donné lieu à la Réforme, au XVIe siècle, ou à celle qu’a induite la Constitution civile du clergé en 1790. Pour la comprendre, il faut la replacer dans la durée, remonter au XIXe siècle et à la confrontation de l’Église avec le bouleversement que constitue, à la Révolution, l’affirmation du droit des individus à l’autonomie, qui est le cœur de notre modernité.
Celle-ci s’est imposée d’abord sur le terrain politique. Cette modernité à laquelle se heurte alors l’Église, c’est la reconnaissance de l’autonomie des citoyens, qui fait échapper la société à la régie de la religion. Or cette revendication d’autonomie n’a pas cessé de s’élargir et elle embrasse aujourd’hui la sphère de l’intime aussi bien que la vie morale et spirituelle des hommes et des femmes qui, sans cesser d’ailleurs nécessairement d’être croyants, récusent la légitimité de l’Église à dire la norme dans des registres qui ne relèvent que de leur conscience personnelle.Le christianisme n’est pourtant pas étranger à cette quête d’autonomie ?
En effet, en universalisant et en individualisant la problématique juive de l’alliance — celle d’un Dieu qui offre un salut auquel le peuple a la liberté de répondre « oui » ou « non » —, le christianisme affirme cette liberté du sujet croyant, que la Réforme poussera dans sa logique en supprimant les médiations institutionnelles entre Dieu et l’homme. La tension entre cette liberté spirituelle et l’ordre dogmatique et disciplinaire imposé aux fidèles traverse l’histoire de l’Église. Mais cet ordre lui-même a été radicalement mis en cause par la reconnaissance moderne des autonomies individuelles, sur laquelle l’expérience chrétienne elle-même s’est progressivement alignée. Aujourd’hui, le fossé culturel est béant entre la société contemporaine et une Église qui reste arrimée, par-delà le concile Vatican II (1962-1965), à un régime normatif et hiérarchique étranger à cette révolution de l’individu.
Comment l’Église réagit-elle à cet éloignement au XIXe siècle ?
Dans la première partie du siècle, elle pense réversible le cours de l’Histoire. L’ordre nouveau issu de la Révolution n’est pas stabilisé et elle s’engage intensément en vue de la reconquête théologico-politique. Plus la partie apparaît perdue, plus elle se constitue en une « forteresse assiégée » dressée contre la modernité. Refoulée de la sphère politique, elle renforce son dispositif d’emprise en direction de la sphère privée, en transposant sur le terrain des mœurs et des mentalités les anathèmes portés sur les « erreurs fatales » de la démocratie et du libéralisme politique. La famille devient le lieu par excellence de son emprise normative, avec une obsession croissante pour le contrôle de la sexualité des fidèles, principalement à travers la confession.
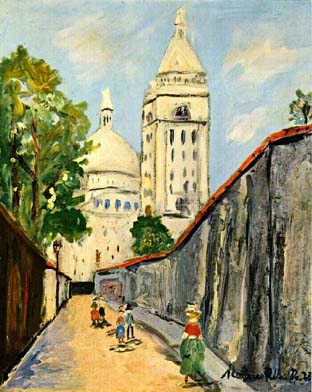
Refoulée de la sphère politique,
l’Église tente d’exercer son emprise sur la famille.Avant le XIXe siècle, l’Église ne s’intéressait pas à la famille ?
Si, bien sûr, et le droit ecclésiastique du mariage constitué bien en amont a d’ailleurs longtemps imprégné en profondeur le droit civil lui-même. Mais pendant des siècles, la réalité familiale n’a pas eu grand-chose à voir avec la famille conjugale — papa, maman et les enfants — qu’on célèbre volontiers aujourd’hui comme la forme « naturelle » et intemporelle de toute famille. Avec la mortalité infantile, la mort des femmes en couches, la fréquence des remariages, la cohabitation des générations, le placement des enfants, etc., le paysage familial était des plus mouvants. Le XIXe siècle est le siècle où s’invente le modèle familial que nous connaissons : celui de la famille bourgeoise centrée sur le couple et sa progéniture. C’est sur cette cellule familiale, érigée en « cellule d’Église », que l’Église va concentrer massivement ses efforts de contrôle.
Comment s’y prend-elle ?
À travers le contrôle du corps des femmes d’une part, et la magnification de la figure du prêtre comme homme du sacré, d’autre part. Après la Réforme, le concile de Trente (1545-1563) avait puissamment renforcé le statut du prêtre, « mis à part » pour la gestion exclusive des biens de salut. L’emphase portée sur l’élection divine du prêtre, dont la vocation est appelée à se développer comme un « germe » à l’abri du monde dans le milieu fermé des séminaires, triomphe au XIXe siècle, « siècle des curés ». Face à un peuple de fidèles sans aucun pouvoir au sein de l’institution, s’impose la figure d’un prêtre porteur de tous les attributs du sacré, qui est aussi, sur le terrain de la famille, le héros de la grande bataille de l’Église contre la sécularité du monde.
Vous évoquiez le “deuxième pivot” du dispositif : le corps des femmes…
L’Église a mis en place un idéal du couple et de la famille aligné sur le modèle de la Sainte Famille, récapitulant à la fois la soumission au Dieu-Père (avec la figure du pater familias), l’absolu du dévouement maternel, et la préservation parfaite de la pureté. Dans la poursuite de cet idéal, le prêtre est chargé d’exercer un contrôle quasiment direct sur le corps des femmes. Pourquoi elles ? Parce que les hommes sont moins pratiquants que les femmes, parce que la transmission religieuse se fait essentiellement par les mères, et parce que celles-ci font naître de futurs prêtres. L’obligation faite aux prêtres (sous peine de grave manquement) d’interroger les pénitents en confession sur la conformité de leurs pratiques sexuelles concerne principalement les pénitentes… Ce rappel de l’histoire est indispensable, selon moi, pour comprendre la crise actuelle de l’Église.
Pourquoi ?
Parce que l’on a connu, avec les deux Guerres et surtout depuis les années 1960-1970, une révolution complète de la famille : le modèle patriarcal et hiérarchique du XIXe siècle a été submergé par la montée de la « famille relationnelle » ou « horizontale », au sein de laquelle priment, sur un mode contractuel, les relations entre individus. La reconnaissance de l’égalité des femmes et de leur droit à disposer de leur propre corps a sapé le bastion familial sur lequel l’Église ancrait son effort d’emprise sur la société. L’Église a été, si j’ose dire, « lâchée par la famille ».
L’acclimatation paisible du mariage entre personnes de même sexe, à laquelle l’Église s’est violemment opposée, achève ce décrochage. Ses positions officielles sur la contraception, ou sur la procréation médicalement assistée interdite — au nom d’une « nature » réduite à la biologie — même aux couples hétérosexuels mariés, sont incomprises, et évidemment contournées, par ses propres fidèles. Dans ces combats illisibles, l’Église a perdu une part substantielle de son crédit. Les scandales liés aux affaires de pédophilie marquent une nouvelle et dramatique étape, en déconsidérant, chez les fidèles eux-mêmes, le caractère sacré attaché à la personne du prêtre.
La figure idéale du prêtre s’écroule.
Quelle était la formation des prêtres sur les questions touchant à la sexualité ?
Jusqu’au milieu du XXe, dans le monde clos des séminaires, la question des implications vécues du célibat était un point aveugle. La sexualité du prêtre était exclusivement envisagée sous l’angle de la tentation, qu’un « bon prêtre » qui prie beaucoup et se mortifie parviendra à éviter. Des consignes de prudence étaient transmises en matière de rapports avec les femmes, mais pour le reste, le silence régnait. À partir des années 1960, du fait notamment du nombre montant des prêtres abandonnant le sacerdoce, ces questions ont été peu à peu introduites dans la formation par le biais de la psychologie, mais non sans réticences, la question de l’homosexualité restant la plupart du temps un trou noir. L’institution n’ignore pas que le simple fait de poser ces questions menace d’explosion tout le dispositif de la « mise à part » du prêtre.
Pourquoi ?
Parce que le coût de la « mise à part » est devenu plus lourd à porter. Le futur prêtre qui entre aujourd’hui en formation participe d’une culture postchrétienne au sein de laquelle l’évidence sociale de son statut s’est considérablement réduite. Il sait que les bénéfices symboliques attachés à ses renoncements seront faibles, que sa situation économique sera médiocre et ses conditions de travail pastoral désastreuses, souvent dans l’isolement. Il sait qu’il sera la plupart du temps perçu non pas comme un virtuose de la foi mais comme le dernier des Mohicans. La prêtrise est devenue une position sociale largement disqualifiée, que les affaires de pédophilie fragilisent aujourd’hui dramatiquement.
L’Église a-t-elle pris la mesure de ce scandale ?
Son aveuglement durable s’explique par ce que je viens de décrire. En faisant du prêtre une figure idéale dans laquelle toutes les contradictions humaines pouvaient être résorbées par la prière et la mortification, l’Église se protégeait assez bien contre les défaillances de certains : ramenés à de simples « dérives individuelles », ces comportements n’étaient pas censés compromettre l’ensemble de l’institution. Et cela d’autant moins que la sacralité - qui leur restait conférée par-delà ces manquements - rendait intouchables les prêtres concernés, y compris aux yeux de parents de victimes souvent dans le déni.
Cette attitude a laissé livrés à eux-mêmes les enfants abusés, mais aussi les prêtres les plus fragiles psychologiquement. On s’étonne, évidemment, de la durée de ce silence coupable. Mais ceux qui assuraient la régulation du système étaient incapables de mesurer l’enjeu, persuadés — non sans raisons d’ailleurs ! — que si l’on brisait le silence, on ébranlerait les fondements mêmes de l’autorité cléricale, et donc l’Église elle-même. Ils n’étaient pas — ils ne sont toujours pas, pour un certain nombre d’entre eux — prêts à prendre ce risque. Ils sont aujourd’hui soumis à un cataclysme.Pourquoi, sur le scandale de la pédophilie, la France a-t-elle semblé à la traîne par rapport à d’autres pays ?
Sans doute parce que la culture du secret, que nourrit l’idée selon laquelle la sainteté de l’institution absorbe le péché de ses ministres, y est redoublée par l’inhibition particulière que crée, au sein de l’institution, le souci de ne pas ébranler l’équilibre péniblement atteint dans ses relations avec une société qui prend feu dès que l’Église est concernée. Dès qu’on touche à l’Église dans notre pays, on réactive la guerre des deux France. Sans doute aussi parce que la Conférence épiscopale est profondément divisée sur ces questions, comme sur beaucoup d’autres.
Elle vient cependant de se résoudre, sous la pression, à la création d’une commission d’enquête indépendante. C’est un pas en avant. À condition que celle-ci soit véritablement indépendante et ait un accès parfaitement libre à l’ensemble des archives, dans tous les diocèses sans exception. On sait que ce ne fut pas le cas en Allemagne, par exemple. Mais si la création de cette commission marque une étape dans le dossier de la pédophilie, il n’est pas certain que l’Église s’affronte aux causes structurelles de la crise.
« Il faut déconstruire le système clérical
pour inventer une autre manière de faire Église. »Comment peut-elle sortir de cette crise ?
Le « système clérical », auquel on impute désormais les dérives gravissimes qui explosent au grand jour, n’est pas réformable. Or c’est ce système même qu’il faut déconstruire si l’on veut inventer, si c’est possible, une autre manière de faire Église. Celle-ci ne peut plus séparer la redéfinition radicale du sacerdoce comme service de la communauté et la reconnaissance pleine et entière de l’égalité des femmes dans toutes les dimensions, y compris sacramentaires, de la vie de l’Église.
L’invitation faite aux prêtres d’être proches de leurs ouailles, la place faite à quelques femmes dans les instances du pouvoir, et même l’ouverture de l’ordination à quelques hommes mariés dûment sélectionnés ne conjureront pas le désastre. La question qui est sur la table est celle du sacerdoce de tous les laïcs, hommes et femmes, mariés ou célibataires selon leur choix. Une seule chose est sûre : la révolution sera globale ou elle ne sera pas, et elle passe par une refondation complète du régime du pouvoir dans l’institution.Reste le message spirituel de l’Église…
Sans doute, mais transmis par qui ? Depuis 1959, il meurt chaque année en France plus de prêtres qu’on n’en ordonne. Crevons l’abcès : sur le plan des effectifs, le corps sacerdotal est en voie d’extinction. Hors des grandes villes, les paroisses sont couramment des coquilles vides, où des prêtres s’épuisent en enchaînant au kilomètre messes et enterrements ! L’Église de France ne pourra pas indéfiniment faire appel à des prêtres africains ou polonais pour compenser l’effondrement des vocations. La sociabilité catholique repose aujourd’hui massivement sur la générosité de femmes laïques qui prennent en charge le catéchisme, la préparation au mariage ou au baptême, tout ce qui engage centralement la transmission chrétienne. Qu’elles s’arrêtent de travailler et le catholicisme en France s’effondre. Or on sait déjà que leur relève est des plus problématique.
Alors, quelle Église pour demain ? Le théologien Karl Rahner l’écrivait déjà en 1954, avec un sens aigu de la prémonition : face au risque de voir se constituer un « catholicisme de ghetto », il va falloir inventer, disait-il, un « catholicisme de diaspora ». Une telle mutation « diasporique » suggère une autorité ecclésiale capable d’accompagner la prise en charge des communautés par elles-mêmes, dans les conditions culturelles spécifiques des sociétés où elles sont implantées. L’observation sociologique de la scène catholique ne laisse guère deviner la proximité d’une telle révolution.
Danièle Hervieu-Léger
Peintures de Utrillo

