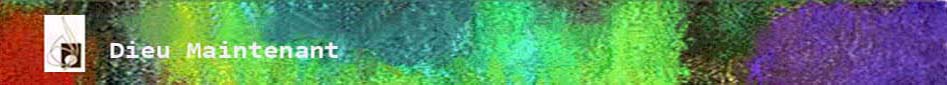

Morale catholique et violence sexuelle
Matthieu Poupart
Matthieu Poupart, collaborateur à La Vie, a accompagné la réception du rapport Sauvé. Il a participé à un groupe de travail pluridisciplinaire destiné à analyser les causes des abus et leur caractère systémique. Puis il est passé de ce travail collectif à une démarche qui l’a conduit à l’écriture du livre Le silence de l'agneau. La morale catholique favorise-t-elle la violence sexuelle ? (Le Seuil, octobre 2024). Dans cet entretien, il nous fait part des principaux axes de son analyse.
Extraits de l’entretien avec Matthieu Poupart « La morale catholique favorise-t-elle la violence sexuelle ? » (RTBF, 14/12/2024) : https://www.youtube.com/watch?v=SAU-FXVkv0c

Question : Vous avez participé à l’un des groupes de travail suscités par l’épiscopat, après le rapport de la CIASE, sur les crimes et abus dans l’Église. Pouvez-vous décrire brièvement l’objet de votre travail et la manière dont l’épiscopat l’a reçu ?
Il y avait neuf groupes de travail, chacun composé d’une dizaine de personnes — entre dix et douze à peu près. Des profils très variés : des religieux, des laïcs, des victimes ou proches de victimes, des gens issus des sciences humaines, médicales, théologiques… bref, au total, un peu plus d’une centaine de personnes. Et, je crois pouvoir dire qu’il y avait une certaine unanimité dans le sentiment de déception au moment où on a remis nos rapports à l’épiscopat.
Moi, j’étais responsable d’un groupe dont le thème était particulièrement large : « l’analyse des causes des violences sexuelles commises dans l’Église ». Avec ce groupe, on a voulu mettre en lumière différentes causalités, toutes ces causes multiples qui, d’une manière ou d’une autre, favorisent les agresseurs et fragilisent les victimes. Certaines causes étaient d’ordre organisationnel : la manière d’exercer le pouvoir dans l’Église, les logiques d’entre-soi, très répandues dans les milieux clos, et qui sont si utiles aux agresseurs pour enfermer leurs victimes dans des cercles restreints. Et puis, il y avait aussi des causes morales, culturelles, anthropologiques : des représentations mentales, des discours qui, sans le vouloir, servent les agresseurs et nuisent aux victimes.
Ces représentations, on les retrouve avant l’agression — quand elles justifient moralement des situations dangereuses ; on les retrouve pendant — quand elles dépouillent la victime de sa liberté intérieure, celle qui lui permettrait peut-être de résister ; et on les retrouve après — quand elles empêchent la communauté catholique de comprendre ce qui s’est passé, rendant les témoignages des victimes presque inaudibles. Tout cela contribue à l’impunité des agresseurs. Cette mise en lumière des causes morales a été accueillie avec une certaine froideur par nos commanditaires épiscopaux.Comment expliquez-vous cette froideur des évêques ?
D’abord à cause d’un climat de méfiance. En contexte religieux, dès qu’on propose un regard critique sur des discours pastoraux ou doctrinaux, la suspicion arrive vite. Mais aussi à cause de vraies difficultés intellectuelles. D’un côté, quand on décrit des idées très répandues dans certains milieux catholiques, les évêques ou les supérieurs religieux nous disent : « Oui, c’est dangereux, mais ce n’est pas dans le catéchisme, ce n’est pas ce qu’on nous a appris au séminaire. Donc ce n’est pas notre doctrine. » Et de l’autre, quand on pointe des ambiguïtés dans des textes officiels — le catéchisme, par exemple —, ces mêmes personnes répondent : « Peut-être, mais enfin, vous n’allez pas me dire que les agresseurs sexuels lisent le catéchisme ! Donc ce n’est pas ce qui y est écrit qui provoque les agressions dans le monde réel. »
Pouvez-vous donner des exemples de représentations délétères qui circulent dans certains discours pastoraux ?
L’un des schémas les plus répandus dans la pastorale récente, c’est l’association — voire l’enfermement — de la féminité dans la sphère de la séduction. J’ai relevé un grand nombre de textes pastoraux de ces dernières décennies, et parfois je me suis demandé, ironiquement, si leurs auteurs savaient que « séducteur » existe aussi au masculin. Alors que, dans la Bible, le mot est exclusivement masculin. En plaçant la séduction du côté féminin, on finit par attribuer la responsabilité du surgissement du désir à la posture qui est traditionnellement vue comme passive.
Quand ce paradigme se transpose dans des situations d’agression, même quand la victime est un jeune garçon, il produit une idée perverse : le « responsable » du désordre sexuel, serait celui ou celle qui n’a rien fait. On comprend à quel point ce schéma renforce les agresseurs. En binôme avec cette « séduction féminine », il y a une complaisance — très peu chrétienne d’ailleurs — à l’égard des pulsions masculines : cette idée que « l’homme, lui, ne peut pas s’empêcher », qu’il est « submergé par le désir ».Enfin, il y a ce que j’appelle un aveuglement : un vide intellectuel total sur la question de la violence. J’ai grandi dans les années 2000. À l’époque, la pastorale catholique parlait beaucoup de sexualité — du mariage, de la chasteté, de la pornographie, de l’homosexualité — mais jamais de violence, jamais d’agression, jamais de consentement. Or, on trouve, par exemple chez saint Augustin, des réflexions très fortes sur la violence sexuelle. Dans La Cité de Dieu, il écrit quatre chapitres entiers « pour les victimes de viol ». Quatre chapitres ! Je n’ai jamais vu ça dans un livre de spiritualité catholique récent. J’ai vu, dans mon entourage, une victime de viol sur mineur en Église se reconstruire grâce à ce que saint Augustin avait écrit il y a seize siècles. C’est dire la force de cette tradition, et la responsabilité qu’a la pastorale d’aujourd’hui de la transmettre à nouveau.
Faut-il une parole claire de l’Église sur le consentement ?
Je pense qu’il faudrait une parole très forte du magistère sur cette question. Mais avant de dire ce qu’il faudrait faire, il faut comprendre pourquoi la situation actuelle est problématique. Depuis les années 1970, les pasteurs ont produit leur discours dans un contexte inédit : celui de la « libération sexuelle ». Face à cette révolution des mœurs, l’Église a voulu proposer un contre-discours. Et ce contre-discours, parfois, a pris la forme d’une méfiance — voire d’un rejet — envers tout ce qui, de près ou de loin, ressemblait au langage du consentement. Parce que ce mot, « consentement », était vu comme un cheval de Troie du libertinage : « du moment que deux adultes sont d’accord, tout est permis ! »
Mais en rejetant le concept, on a oublié que le consentement, chez saint Augustin déjà, était une notion centrale pour distinguer la faute morale de l’agression. Quand on le met de côté, on finit par tout mélanger — et surtout par dissoudre le viol dans le libertinage. C’est ce que font les agresseurs quand ils se confessent : « Mon père, j’ai commis une fornication » — au lieu de dire « J’ai commis une agression sexuelle ». Il y a là une confusion dramatique, à laquelle la pastorale a trop souvent prêté la main.
De même que l’Église a mis du temps à comprendre que la liberté religieuse ne contredisait pas la foi, mais en était le cœur — de même, aujourd’hui, elle doit redécouvrir que la liberté sexuelle ne contredit pas la morale chrétienne : elle en est le fondement. La sexualité humaine repose sur la liberté. Il ne s’agit pas d’une concession moderne : c’est une des pierres de fondation de l’éthique chrétienne.Dans votre livre, vous faites tout un développement sur la sainte martyre Maria Goretti. Pouvez-vous nous expliquer qui elle était et quel est le problème avec ce qui entoure cette sainte ?
Je vais commencer à rebours. Pour comprendre l’histoire de sainte Maria Goretti, il faut remonter bien plus loin, à l’Antiquité. Maria Goretti (1890-1902) est une jeune fille canonisée comme « martyre de la chasteté ». Rien que cette expression est déjà surprenante. Parce qu’à l’origine, dans le christianisme, un martyre, c’est quelqu’un qui meurt en défense de la foi, pas en défense d’une vertu morale. Ce n’est que beaucoup plus tard, à l’époque moderne, qu’on a commencé à parler de « martyres de la charité » (comme Maximilien Kolbe, mort à la place d’un autre à Auschwitz), ou de « martyres de la chasteté ».
Pour comprendre d’où vient cette idée, il faut se tourner vers les premiers siècles du christianisme, avec les récits des vierges martyres. Parmi ces vierges martyres, la plus célèbre est sainte Lucie de Syracuse. On raconte que, parce qu’elle refusait de sacrifier aux dieux de Rome, le procureur la condamne à être violée dans un lupanar avant d’être exécutée. Ce qu’il veut, c’est la « souiller », la dégrader. Et là, le texte prend une tournure extraordinaire : Lucie lui répond que son corps ne sera jamais souillé, car le corps n’est souillé que si l’esprit y consent. Elle invente en quelque sorte une théologie du consentement : même si on la force, son âme restera intacte, car elle n’aura pas consenti. En latin, elle dit : consensus mentis, le consentement de l’esprit.C’est peut-être la première fois, dans l’histoire, que l’idée de consentement sexuel est formulée aussi clairement. Et elle l’est dans un contexte chrétien, pour protéger les victimes, pour leur dire : « Tu n’as pas à avoir honte. » Autrement dit, à l’origine, ce discours sur la pureté n’accusait pas les victimes : il les consolait. Mais, avec les siècles, tout cela change. Au fur et à mesure que l’Europe se christianise, il y a moins de persécutions, donc moins de martyrs de la foi. Et peu à peu, les récits de martyres se transforment. On continue à raconter des histoires de jeunes femmes tuées pour leur vertu, mais la tonalité se déplace. On insiste de plus en plus sur la chasteté plutôt que sur la foi.
Comment est-on passé d’une sainte Lucie de Syracuse, martyre de la foi à une sainte Maria Goretti, martyre de la chasteté ?
Avec le concile de Trente (XVIe siècle), l’Église entre dans la modernité et la théologie morale change de visage. Deux choses importantes se passent. D’une part, on en vient à considérer que tout péché sexuel, s’il est commis librement et en connaissance de cause — que ce soit la masturbation, l’adultère, le viol, peu importe — est un péché mortel. Et mourir en état de péché mortel, c’est aller en enfer. D’autre part, la théologie morale devient plus psychologique. On passe d’une réflexion philosophique sur la nature du bien et du mal à une théologie du confessionnal : un prêtre face à un fidèle, qui cherche à mesurer sa faute. C’est ce qu’on appelle la casuistique : la réflexion morale à partir de cas concrets.
Le problème, c’est que cette approche se concentre sur la culpabilité, pas sur l’innocence. Elle ne sait pas penser la victime. On cherche à savoir si tel acte est péché, pas à consoler ou comprendre celui qui souffre de l’acte commis contre lui. Et quand la théologie s’intéresse malgré tout aux victimes, elle le fait avec la même logique accusatrice : si, dans la confusion ou la peur, une femme violée a eu une réaction charnelle, ne serait-ce qu’un instant, alors on considère qu’elle a consenti. Donc qu’elle a commis un péché mortel. Et comme tout chrétien doit éviter le péché mortel même au prix de sa vie, on en vient à dire : « Une femme menacée de viol doit se laisser tuer plutôt que de risquer d’y consentir. »
C’est ainsi qu’est née l’idée du « martyre de la chasteté ». Non plus comme un cri d’espérance pour les victimes, mais comme un modèle culpabilisant : celle qui meurt « a bien fait », celle qui survit « a failli ». C’est dans ce contexte que naît le culte de Maria Goretti. Maria, 12 ans, poignardée à mort par un voisin qui voulait la violer. On la canonise, non pas seulement pour sa mort tragique, mais pour avoir « préféré mourir que céder à la tentation ». Et c’est là que le retournement devient évident : la logique de sainte Lucie — « mon âme reste pure même si mon corps est forcé » — s’inverse. Désormais, c’est la mort qui devient le signe de la pureté.
Des femmes comme Véronique Garnier, victime d’abus dans l’enfance, l’ont très bien perçu. Elle raconte combien cette figure de Maria Goretti a pu lui être insupportable : « C’est un récit qui m’accuse. Qui me dit que j’aurais dû mourir plutôt que subir. » Et quand elle en parle à des responsables d’Église, on lui répond souvent : « Mais non, vous interprétez mal, personne ne vous accuse… » Et pourtant, historiquement, c’est faux : cette notion a bel et bien été formulée dans un contexte d’accusation implicite des victimes survivantes. Le « martyre de la chasteté » n’est pas une vérité de foi, c’est une construction pastorale récente, née de la culpabilisation des victimes vivantes et de l’idéalisation de celles qui sont mortes.
Diriez-vous que les crimes et abus sexuels dans l’Église sont d’ordre systémiques ?
Le mot « systémique » fait peur, mais il est indispensable. Dire qu’un abus est « systémique », c’est reconnaître que ça ne se joue jamais à deux, entre un agresseur et une victime. Il y a toujours un troisième acteur : la communauté autour. C’est elle qui a créé le contexte où l’abus a pu se produire ; c’est elle qui a donné à l’agresseur le sentiment d’être protégé, et à la victime le sentiment d’être sans recours. Un film comme Spotlight l’a montré avec force. Un des personnages y détourne le proverbe : « Il faut tout un village pour éduquer un enfant » devient « Il faut tout un village pour violer un enfant. »
Et c’est vrai. Il faut tout un milieu qui trouve ça « normal », ou du moins qui regarde ailleurs. C’est ce tissu collectif, cette culture du silence, qu’il faut réformer. Parce qu’au fond, si une communauté se dit vraiment : ici, on ne viole pas d’enfants, alors même le pire des agresseurs ne pourra rien faire. L’Église doit devenir ce village-là. Et aujourd’hui, elle ne l’est pas encore.Selon vous, la morale catholique favorise-t-elle la violence sexuelle ?
Tout dépend de ce qu’on entend par « morale catholique ». Si on parle du discours concret tenu dans certains milieux, dans le clergé ou dans des groupes chrétiens marqués par une culture particulière, alors oui : certaines représentations de la sexualité ont clairement servi les agresseurs et fait du mal aux victimes.
Mais si on parle du catholicisme théologique, celui de l’Évangile, de la tradition spirituelle la plus profonde, alors c’est tout le contraire. Là, il y a des ressources immenses pour comprendre la violence, pour protéger les faibles, pour libérer la parole et pour guérir. En somme : ce n’est pas la foi qui favorise la violence, c’est la trahison de la foi par une culture qui a oublié son cœur évangélique.
Matthieu Poupart, mise en ligne novembre 2025
Tableau de Lorenzo Lotto : Sainte Lucie de Syracuse devant le juge Paschasius

