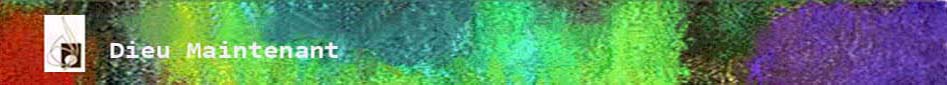

Handicap, le retard français : un témoignage
Julien et Sarah
La France a un problème avec le handicap : elle ne l’a réellement reconnu dans une loi-cadre qu’il y a vingt ans, en 2005. C’est la preuve d’un retard considérable sur un sujet qui touche des millions de personnes. Cet article n’est pas une analyse socio-politique mais le témoignage de parents dont les deux enfants sont porteuses d’un handicap. Il raconte le parcours du combattant pour faire valoir leurs droits, trouver les bons professionnels de santé et veiller à la bonne application des aménagements scolaires.

Le handicap invisible : la double peine
Nous sommes parents de deux filles en situation de handicap invisible. Elles sont porteuses d’un trouble du neurodéveloppement (TND), qui rend leur fonctionnement différent, sans déficience intellectuelle, mais induit une sensibilité sensorielle accrue, comme une difficulté majorée à supporter le bruit ou le contact des foules, et des difficultés dans la relation aux autres, comme l’adaptation aux codes sociaux. Plus clairement, elles sont porteuses d’un Trouble du Spectre Autistique (TSA). L’aînée est de type « Asperger », bien que le terme ait été désormais retiré du vocabulaire médical, et la cadette présente une situation plus complexe qui entremêle un TSA léger couplé à une hyperactivité avec déficit attentionnel (TDAH). De plus, des analyses génétiques réalisées par le centre de diagnostic hospitalier ont révélé chez elle une anomalie chromosomique qui explique les difficultés de langage qu’elle a pu avoir à l’école maternelle et primaire. Enfin, les TND ne sont jamais uniques car ils s’accompagnent d’autres particularités. Chez nos filles, il s’agit de difficultés graphomotrices qui ont justifié le droit à l’usage de matériel pédagogique adapté pour limiter la fatigue musculaire de l’écriture manuscrite à l’école. Avec ces aménagements, elles sont scolairement performantes.
Le terme de « trouble » utilisé pour désigner la neurodifférence est parfois réfuté, et plus encore celui-là même de « handicap ». Il est toutefois juste qu’on ne dise plus « une personne handicapée », pour ne pas la réduire qu’à cela, mais « en situation de handicap ». Cependant, il est fondamental de conserver le terme de « handicap », et vouloir le supprimer parce qu’il serait stigmatisant, au nom d’une prétendue bienveillance, ferait en réalité plus de mal que de bien. Pourquoi ? Parce que le terme de handicap est fondamentalement un terme de droit. Faire valoir le handicap, c’est avant tout reconnaître qu’une personne dans cette situation a droit à des compensations, et que celles-ci constituent pour elle un droit fondamental. La devise républicaine est « Liberté, Égalité, Fraternité ». Or pour parvenir à la liberté et à l’égalité comme un idéal citoyen, il faut corriger au mieux ce qui entrave la liberté de ces personnes et l’égalité citoyenne par des compensations. Il s’agit de choses très concrètes comme la liberté et l’égalité d’accès au travail, à l’éducation, aux transports, aux lieux publics, aux sports et loisirs, à la culture, aux soins médicaux, etc. Et cela passe par la reconnaissance officielle, légale, de leur handicap. On peut enfin rajouter qu’une société mieux sensibilisée au handicap sera plus fraternelle avec les personnes qui en sont porteuses.
Et c’est là où la question de la sensibilisation au handicap accuse un sérieux retard en France. Nous le disons sans détour à partir de notre expérience sociale souvent difficile de parents d’enfants en situation de handicap : la société française est normative et intolérante. Avoir des enfants différents, et surtout d’une différence invisible, a agi comme un révélateur de ce triste constat. Comme le répètent de nombreux acteurs du handicap, la signalétique employée depuis des décennies est désastreuse. Elle a résumé le handicap à l’appareillage lourd, celui du fauteuil roulant, contribuant ainsi à l’ignorance la plus totale de la grande diversité de ses formes. Or 80% du handicap est invisible, y incluant d’ailleurs de nombreux cas de handicap physique, et pas uniquement psychiques. Ainsi, une championne paralympique française a témoigné des agressions verbales qu’elle subit lorsqu’elle stationne sur les places réservées avec sa voiture, et qu’elle en sort sans appareillage. Elle se fait réprimander par des gens autoérigés en flics du handicap, et bien qu’elle leur désigne le macaron sur son pare-brise, ils n’en démordent pas et menacent même d’appeler la police. Ce dont témoigne cette sportive de haut-niveau, les personnes dans des situations similaires le subissent au quotidien. Pour nos filles, leurs difficultés d’adaptation sociale ont pu les faire passer pour des enfants mal éduquées, et nous comme de mauvais parents. Lorsqu’elles présentent leurs cartes mobilité inclusion (CMI) pour bénéficier des coupe-files, c’est souvent la même ambiance réprobatrice, agressive, qui se dégage autour d’elles. On les scrute des pieds à la tête car elles ont l’air « normales ».
C’est donc le monde à l’envers : les personnes en situation de handicap sont sommées de se justifier face à des quidams qui en ignorent tout, autoproclamés justiciers. L’ignorance est mère de la bêtise. Ainsi, l’invisibilité de la majorité des handicaps constitue une double peine pour les personnes concernées.
Autisme : le retard français
Si nous en revenons au handicap dont sont porteuses nos deux filles, l’autisme, nous allons essayer de résumer le parcours du combattant que nous avons vécu, et continuons de mener.
En premier lieu, nous souhaiterions dénoncer la mainmise encore trop présente de l’interprétation psychanalytique de l’autisme en France, qui est totalement fausse du point de vue scientifique. Pire encore, cette conception ne reposant sur aucune base sérieuse, accusant la mère d’être la responsable inconsciente de l’autisme de son enfant, a détruit des vies. La psychanalyse est une passion française, qui a longtemps exercé un magistère dominant à l’Université, à la manière d’un système de pouvoir. Les considérations intellectuelles de la psychanalyse peuvent séduire à la manière de jeux de langage. Mais, précisément, elles ne devraient plus du tout être déclinées en discipline clinique, chargée de diagnostiquer des enfants, et de proposer ensuite des thérapies de remédiation. A cause du dogme psychanalytique sur l’autisme, la France accuse un retard considérable en comparaison d’autres pays, comme le Canada en particulier, qu’elle tente depuis de rattraper. De plus, les tenants de la psychanalyse ont mené des obstructions judicaires contre les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) sur les procédures de dépistage précoce de l’autisme, et ce jusqu’à l’échelon du Conseil d’Etat.
C’est dans cette impasse que nous sommes d’abord tombés avec nos filles. Dès la maternelle, le comportement déroutant de notre fille aînée a fait l’objet d’alertes de ses enseignantes. La psychologue scolaire, qui avait eu pourtant la bonne intuition à laquelle nous n’avions d’abord pas cru, nous a orienté vers le Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) de notre secteur. Grave erreur, qui nous a fait perdre de précieuses années. A aucun moment, le terme d’autisme n'y a été prononcé, ni même une once de diagnostic. Au lieu de cela, nous avons eu le droit à un déballage de termes psychanalytiques, aucunement partagés dans la communauté médicale. Le plus délirant que nous ayons encore en mémoire est celui de « dysharmonie évolutive » pour caractériser notre fille. Plus encore, le CMPP ne nous a jamais proposé de monter un dossier de demande de reconnaissance de handicap. Et lors des équipes de suivi de scolarité, la psychologue référente, en réalité une psychanalyste, nous intimait de ne rien dire. Elle restait dans le nébuleux, chose fort peu pratique pour orienter les profs dans l’adaptation de leurs enseignements. Depuis cette aventure, notre fille aînée ne supporte plus tout ce qui ressemble de près ou de loin à une psychologue.
Lorsque sa sœur cadette s’est rapprochée de l’entrée en maternelle, les responsables de la crèche ont souhaité nous rencontrer. Nous avons été reçus par une psychologue totalement formatée qui nous a déclaré vouloir la garder une année de plus en crèche, lui faisant ainsi retarder d’un an son entrée à l’école. Interloqués par une telle proposition, nous lui en avons demandé les raisons. Et vous allez rire : parce qu’elle ne dessinait pas de bonhommes-patates et qu’elle ne jouait pas à la poupée ! Nous avons dû faire un immense effort pour ne pas lui voler trop fortement dans les plumes. Mais il s’avère que notre fille a commencé à rencontrer des difficultés similaires à celles de sa sœur à l’école, et nous avons demandé qu’elle soit suivie au CMPP.
Durant plusieurs années, nous avons été égarés dans cette structure aux mains de personnes sectaires et dissimulatrices. Et nous constations, désemparés, que la situation de nos filles ne s’améliorait pas. Car il nous faut ici le répéter : l’autisme n’est ni une maladie, ni une bénédiction. On ne guérit pas de l’autisme, c’est une neurodifférence acquise, mais pour laquelle des remédiations compensatrices peuvent permettre une vie incluse dans la société. A l’inverse, une vision romantique de l’autisme, vu comme une sorte de génie de l’originalité, est tout aussi nocive. Car les personnes porteuses d’un TSA, si elles ne sont ni diagnostiquées ni prises en charge sérieusement, en éprouvent de grandes souffrances. Et c’est ce qu’ont vécu de trop nombreuses années nos deux filles à cause de ce CMPP.
Nous avons alors commencé à douter, et grâce aux conseils de notre médecin généraliste, nous avons déposé une demande dans un centre de dépistage spécialisé sur les TND, en milieu hospitalier. Enfin, le diagnostic sérieux y fut posé, à la suite d’une batterie de tests, de questionnaires et de consultations. Nous avons réussi à nous tirer des griffes des psychanalystes du CMPP qui avaient tout fait pour nous rendre dépendants. A notre avis, les raisons de telles pratiques sont d’abord financières : plus il y a d’enfants conservés dans le CMPP, plus cela maintient les subventions et les postes par conséquent.
Et cette stratégie de captation va encore plus loin, en s’étendant à des réseaux de structures. Lors de l’entrée en sixième de l’aînée, la référente nous a proposé de la scolariser dans une leurs institutions éducatives, ce qui l’aurait fait encore plus stagner. Ce qu’elle a vivement refusé. Grâce aux aménagements dont elle a bénéficié en milieu ordinaire, elle a obtenu son bac général option mathématiques et langue vivante avec la mention Très Bien. Elle est actuellement en première année universitaire de maths-physique pour préparer les écoles d’ingénieurs.
Quant à la cadette, lors du dernier rendez-vous de bilan avec sa psychologue du CMPP, nous lui fîmes remarquer que nous la trouvions de plus en plus angoissée, et que nous ne percevions pas bien en quoi elle la faisait progresser. Cette dame s’est soudain mise à trembler des mains. Elle nous a dit que notre fille était probablement porteuse d’un TSA, quoi qu’elle soit non qualifiée comme médecin pour le formuler officiellement. Depuis environ trois ans qu’elle la suivait, elle avait volontairement tu cette hypothèse. Depuis, notre fille cadette a suivi sa scolarité en milieu ordinaire, avec des aménagements, et est actuellement en classe de troisième, où elle obtient de bons résultats, et se destine à entrer en lycée agricole pour vivre sa passion du monde animal.La maltraitance institutionnelle
Un sociologue s’étant penché sur le sujet est parvenu à la conclusion que les institutions chargées du handicap sont souvent plus handicapantes que le handicap lui-même. La formule est abrupte, mais hélas fréquemment vérifiée.
L’institution chargée de reconnaître le handicap, puis d’en qualifier le taux ouvrant droit à des allocations pour financer les prises en charge, est la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). Elle fonctionne comme le guichet unique du handicap pour chaque département, sous la responsabilité du conseil départemental. La première critique qu’on peut faire à cette organisation est son inégalité territoriale. Il n’y a aucune harmonisation nationale, ce qui fait que certains types de handicap ouvrent droit à des niveaux de prestations parfois très différents selon les départements.
Ensuite, produire le dossier de demande est une étape lourde, une paperasse harassante, à renouveler tous les deux ans de surcroît, qui en décourage plus d’un. La logique comptable semble prévaloir, et la première barrière à l’attribution des allocations serait bien celle de la complexité administrative. Un constat étrange qui a nous a conduit à cette hypothèse est la différence systématique de traitement entre nos deux filles. Pour l’aînée, la MDPH nous a toujours accordé le financement adéquat des prises en charge, mais pour la cadette, il nous faut à chaque renouvellement faire une demande de recours car une partie des demandes essuie d’abord un refus. Ce qui implique de faire un dossier complémentaire puis de passer devant une commission de recours. Nous avons fini par nous demander si la MDPH estimait qu’elle donnerait ce qu’il faut pour la première mais serrerait les cordons de la bourse pour la seconde.
La MDPH a aussi des préjugés sociaux tenaces. Lors d’un rendez-vous avec une conseillère et une assistante sociale au sujet de prestations d’accompagnement, l’un de nous deux a précisé qu’il était chef d’entreprise - pas une multinationale, mais une petite entreprise de cinq personnes. Aussitôt, ces dames se sont raidies, en lui assénant sèchement que ce statut ne lui permettait pas de faire des demandes. Des règles parfaitement imaginaires du reste, car aucune loi ne stipule qu’une condition de professionnel indépendant entrainerait la privation de tout droit. Il n’est pas rare que des travailleurs sociaux n’aiment pas avoir en face d’eux des personnes leur permettant moins facilement d’exercer un pouvoir que sur d’autres en fragilité sociale et économique. Et il n’est pas rare non plus que le personnel de la MDPH vous raconte n’importe quoi en matière de droit du handicap. Tout cela porte un nom : la maltraitance institutionnelle.La scolarité
Les relations avec l’Education Nationale nécessiteraient un article entier. De manière générale, c’est une institution systémiquement défaillante à l’égard des élèves en situation de handicap. De la maltraitance institutionnelle s’y produit fréquemment. Nous n’oublions pas toutefois de rendre hommage à des enseignantes et à des enseignants dévoués, et aussi à des CPE, compréhensifs et bienveillants, qui ont permis à nos filles d’acquérir des savoirs et de ramener de bons bulletins. Souvent, ces profs sont eux-mêmes concernés par le handicap de leurs propres enfants ou de proches, ou font preuve d’un effort de compréhension que d’autres négligent. Mais l’institution de l’Education Nationale nous a contraint à un combat sans relâche pour faire valoir les aménagements.
Voici un des épisodes les plus difficiles que nous ayons vécu. En classe de sixième, notre fille aînée s’est faite harceler par une enseignante, bien qu’elle excellait dans sa matière. Cette femme déséquilibrée nous a carrément déclaré qu’elle la trouvait hautaine et arrogante, alors qu’il ne s’agissait que de l’expression de ses difficultés relationnelles, la plaçant dans la réserve. Elle s’est acharnée sur elle. Son comportement inacceptable nous a valu un conflit mémorable avec le principal du collège, qui nous a menacé de poursuites au pénal pour accusations mensongères contre l’enseignante. Il s’est complètement dégonflé quand nous lui avons rétorqué que nous étions prêts à aller au tribunal, sans nous laisser intimider. Le pas-de-vagues de l’Education Nationale est mortifère. Nous n’avons que trop de tragiques exemples dans l’actualité avec le suicide d’élèves harcelés, conséquence de l’absence délibérée de réaction des établissements scolaires.
Cependant, le mal était fait. Le harcèlement par cette enseignante toxique a plongé notre fille dans une phobie scolaire, dont le pic aigu fut une crise d’angoisse monumentale nous obligeant à la faire hospitaliser durant une semaine à l’unité pédopsychiatrique de l’hôpital. Avaler des anxiolytiques à l’âge d’onze ans à cause d’une enseignante que sa hiérarchie a refusé de sanctionner, c’est bien triste. Le seul avantage, si l’on peut dire, c’est que ce principal lâche nous a fait sans hésiter une dérogation pour changer notre fille de collège, où sa scolarité s’est mieux déroulée.
Lorsque la cadette est entrée en sixième, elle a eu droit à un assistant éducatif individualisé (AESH) à temps plein. Tout en commençant ses phrases par un insupportable « Je suis pas psychologue, mais… », la principale du collège nous déclara que pour elle c’était trop, et que le problème n’était pas chez notre fille mais du côté de notre angoisse parentale. Nous dûmes lui rappeler que la décision d’attribuer un AESH à temps plein individualisé ne venait pas de nous mais d’une prescription de sa pédopsychiatre, validée de manière collégiale par la commission d’attribution de la MDPH. Et que par conséquent elle remettait en cause les compétences des professionnels de santé aptes à évaluer les besoins de notre fille. Il va sans dire qu’elle n’a pas vraiment apprécié.
Ce qui est fatiguant, c’est de passer sans cesse pour les méchants. Dès que nous faisons le rappel de la loi aux établissements scolaires, nous sommes accusés de faire des menaces. Si se prévaloir de la loi est une menace, terme désignant un délit pénal, alors plus rien n’a de sens. Bien des responsables administratifs de l’Education Nationale sont les champions de l’inversion victimaire. Alors que nous attendions de l’institution éducative un appui, une démarche collaborative pour aménager la scolarité de nos filles en vue de leur réussite, nous avons surtout vécu beaucoup de conflits. Nous avons perdu confiance dans cette institution, et sans doute dans toutes les autres. Le handicap agit comme un produit révélateur en photographie argentique, et l’image qui se dessine alors des institutions n’est guère reluisante.La France et le handicap
La grande loi-cadre sur le handicap remonte à 2005, par la volonté du président Jacques Chirac. Ce n’était qu’il y a vingt ans, c’est-à-dire hier. Jacques Chirac était un homme sensible au handicap et aux personnes vulnérables, ayant vécu le drame intime de la maladie de sa fille Laurence. Il faudrait aussi ajouter Charles de Gaulle, qu’on pourrait dire en avance sur son temps dans sa manière de vivre avec sa fille Anne, atteinte de trisomie, qu’il n’a jamais cachée, la chérissant, et déclarant qu’elle l’avait rendu meilleur.
Robert Badinter rappelait à juste titre que la France est le pays de la déclaration des Droits de l’Homme, mais pas le pays des Droits de l’Homme. Ce n’est pas parce que l’on déclare quelque chose qu’on est ensuite en mesure de l’appliquer à soi-même. Parmi tant d’autres exemples, la question du handicap éclaire de manière crue cette réflexion.
Dans tout ce lot de combats incessants, de fatigue et parfois de découragement, tous les parents en situation similaire que nous rencontrons nous rejoignent sur ceci : le handicap nous conduit droit à l’essentiel. Bien des choses vous paraissent superflues, bien des vanités, celles que déplore déjà le Qohèleth, s’éloignent de vous par la force des choses. Le handicap nous mène sur un chemin d’exigence, qui se résumerait dans la célèbre maxime de Saint-Irénée : « La Gloire de Dieu, c’est l’Homme vivant ». Le handicap nous rappelle que nous devons rester des vivants, pour nos enfants comme pour nous-mêmes.
Julien et Sarah, parents d’enfants en situation de handicap, Avril 2025
Peinture de Pierre Meneval


