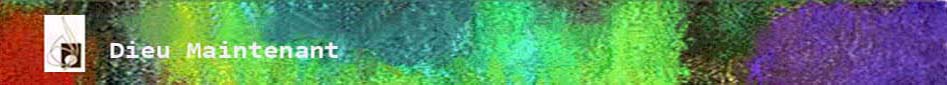

César n’est pas au-dessus des grammairiens
Ecole et puissances politiques
Gildas Labey
Gildas Labey rappelle que « l’une des fins de l’éducation nationale-socialiste apparaît fondée sur la volonté d’amener l’individu en état d’hypnose, l’endormant avec le mythe nazi de la race supérieure, substituant la narration mythique à l’exercice de la raison critique… » C’est pourquoi la défense de l’éducation à la raison critique à l’école est un combat majeur. Au sein des démocraties, l’Ecole d’esprit républicain doit demeurer le premier rempart contre la perversion du langage opérée par certains dirigeants politiques aujourd’hui et les illlusions de tous ceux qui leur emboîtent dramatiquement le pas.

Quand les despotes font dire aux mots jusqu’au contraire de ce qu’ils disent…
L’expression qui fait le titre de ce texte rappelle au moins deux moments de l’histoire antique. Un grammairien, Marcus Pomponius Marcellus, fit remarquer que l’empereur Tibère (-42+37) utilisait dans un édit un mot étranger. On lui répondit que désormais ce terme ferait partie de la langue latine. Ce qui l’indigna : « Tu peux accorder la citoyenneté romaine à des hommes, César, mais pas à un mot ». Lors du concile de Constance (1414) le cardinal Branda Castiglione reprocha à Sigismond 1er l’Ancien, qui avait convoqué ce concile avec l’antipape Jean XXIII, d’avoir utilisé le mot « schisma » au féminin au lieu du neutre. Sigismond répliqua : « Je suis empereur romain et au-dessus de la grammaire ». Le cardinal répliqua : « Caesar non est supra grammaticos ! » « Caesar n’est pas au-dessus des grammairiens ». On peut, enfin, saisir, sinon une référence historique du moins un rappel de principe dans ces deux vers de Molière – Les Femmes savantes, vers 465-466 :
« La grammaire qui sait régenter jusqu’aux rois
et les fait la main haute obéir à ses lois. »
Méditant sur ces mots, on comprend plus clairement que jamais à quoi peuvent nous vouer les agissements et conduites auxquels se livrent aujourd’hui quelques dirigeants politiques, et dans lesquels ils entraînent des foules entières. Toute puissance porte en elle la possibilité d’une toute-puissance, dont les objets principaux sont les mots et les choses. Faire dire aux mots ce que l’on veut, jusqu’au contraire de ce qu’ils disent, en tordre le sens – ce que G.Orwell, dans 1984, a définitivement illustré et thématisé sous le terme de novlangue -, vouloir faire plier le réel à ses désirs, croire qu’il suffit toujours de dire pour faire, ou faire être, tel est le monde irréel, déréalisé, magique du dirigeant halluciné, cauchemardesque pour les autres. Car le rêve des uns est alors la destruction à mort de la résistance des autres, de la résistance de tout « autre ». La folie fantasmatique de ces puissants leur interdit de faire la part du réel et de l’imaginaire, tente de contraindre autrui à plonger dans le vertige abyssal et glacial de la mise à mort de l’altérité, casse toute véracité, vicie radicalement les échanges.L’école : apprendre à ne pas croire n’importe quoi
C’est alors que l’on prend la mesure de tout ce que l’Ecole symbolise, apporte d’essentiel, d’irremplaçable face à ces terrifiantes menées. Car l’Ecole, au fond, est, au plus haut point, un combat politique, un combat de et pour la « raison » et la pensée, contre le déferlement des pulsions et des forces. Et, me semble-t-il, c’est bien ce que les élèves doivent apprendre, c’est-à-dire expérimenter durant la douzaine d’années qu’ils passent sur les bancs scolaires.
Pourquoi l’enseignement de la philosophie, dans certains pays, est-il institué à la fin de la scolarité initiale ? On dit souvent qu’il faut une certaine maturité pour le saisir, qu’il ne peut venir qu’après tous les autres sur lesquels il porte un regard critique, c’est-à-dire en en discernant, en en discutant la portée, les limites, les problèmes. Soit. Mais je dirais que cette position ultime ne se contente pas de mettre un terme au cycle d’études, tout en l’ouvrant à une réflexion à vrai dire aussi interminable que l’intérêt qu’on peut lui vouer et la pratique qu’on veut bien lui consacrer. Il me semble surtout que cette position finale indique un but, une finalité précisément. Que veut-on dire par cela : la philosophie est le but de l’Ecole ? Que dès le cp, et jusqu’en terminale, de façon constante et continue, doit être explicitée et réfléchie la question du sens des apprentissages scolaires. Non pas seulement acquérir des connaissances, des savoir-faire méthodiquement maîtrisés, mais exercer le jugement, c’est-à-dire déterminer par soi-même ce qu’il en est de ce que l’on dit et pense par rapport à ce dont on parle, à ce dont il est question. Apprendre, très tôt, que l’on est personnellement responsable de la vérité, et qu’il existe un ordre de vérité où nul ne peut en conter à personne. On devient ainsi capable de mettre à l’épreuve ses propres pensées et de ne pas croire n’importe quoi. Si l’on regarde bien, aucune discipline n’échappe à cette exigence qui est tout simplement l’exigence du vrai, et leur enseignement devrait, à chaque âge, encore une fois, s’accompagner d’une réflexion sur leur sens.
Dans le temps scolaire, si fondateur, si irremplaçable, s’affirme l’expérimentation de l’autorité souveraine de la raison – autorité dégagée de tout pouvoir contraignant, coercitif, mais qui se manifeste toutes les fois qu’une vérité est comprise, établie, en quelque domaine que ce soit. La raison n’est pas une instance extérieure à soi, mais, comme on le sait, elle est coextensive à soi-même. « Penser par soi-même signifie chercher la suprême touche de la vérité en soi-même (c’est-à-dire dans sa propre raison) » rappelle Emmanuel Kant.
Ce « en soi-même » ne signifie à l’évidence pas « pour soi-même seulement », puisque l’expérience révèle que lorsqu’une vérité est établie, elle ne l’est jamais simplement pour celui qui la découvre et la formule, mais qu’elle implique et produit, librement, l’assentiment de tous, pour peu que chacun « consulte » sa raison précisément. Personne ne dicte quoi que ce soit à autrui, ni ne lui impose de penser ceci ou cela, mais tous, enseignants, élèves, étudiants font un travail commun, un travail public de la raison, en conservent la mémoire, en déploient les possibilités heuristiques. La culture de l’écriture, la pratique, élémentaire déjà, des sciences arment exemplairement les jeunes esprits pour le « penser-par-soi-même » et le sens critique de l’objectivité, de la rationalité.L’enjeu politique essentiel de l’école
S’il faut rappeler tous ces éléments c’est pour faire apparaître l’enjeu politique essentiel de l’Ecole, et la responsabilité du politique. Républicain l’Etat qui institue et garantit des espaces où la seule règle est celle, de génération en génération, de la connaissance et de la pensée, où il s’interdit absolument de juger, de prescrire le contenu de ce qui s’y élabore dans l’extrême diversité des « disciplines ». C’est exactement la même optique qui règle l’idée de laïcité : est instituée et garantie la liberté de tous les cultes sans que l’Etat ne s’immisce en quoi que ce soit dans les contenus de croyance.
La liberté ici n’est pas seulement la libre production du savoir, mais la production d’une liberté de penser, d’expérimenter les possibilités de penser de façon ouverte et publique, d’entretenir dans le public un état d’esprit où rien ne relève d’une ingérence idéologique, partisane, économique, religieuse particulière. Dans ces conditions le désaccord n’est pas un conflit meurtrier, un blasphème, une trahison ni un scandale, le sens des problèmes n’est pas un symptôme d’indécision et de faiblesse, la règle est celle de la possibilité de penser en commun. La liberté est ici sans autres limites que celles des règles de la raison. Cela implique que l’on puisse, dans l’espace public de l’Ecole ou de l’Université garanti par l’Etat, penser sans crainte et librement par exemple une critique radicale de l’Etat. Dès lors peut s’exercer une responsabilité de citoyen, qui suppose une pensée instruite, une liberté éclairée, et sait se hisser à une vue d’intérêt général.
On saisit clairement le profil d’une politique qui détruit délibérément ces principes. Ernst Krieck, un enseignant théoricien de l’éducation nazie, écrivait dans son ouvrage Education nationale politique (1933) : « Toute science qui collabore activement à la mission d’ensemble devient politique et, ainsi que la politique, devient imbue dans ses principes comme dans ses réalisations de racisme, de nationalisme et de national-socialisme, tout comme la culture, l’économie et la pédagogie future. » « Ce n’est pas Weimar, ce n’est pas l’église Saint-Paul de Francfort, avec leurs poètes, leurs philosophes et leurs savants qui ont créé la nouvelle Allemagne, mais c’est l’esprit militaire prussien, l’esprit de virilité, d’énergie défensive, de discipline, d’honneur, de subordination, d’abnégation, de sacrifice » D’une certaine manière l’une des fins de l’éducation nationale-socialiste apparaît fondée sur la volonté d’amener l’individu en état d’hypnose, l’endormant avec le mythe nazi de la race supérieure, substituant la narration mythique à l’exercice de la raison critique, le muthos au logos. Krieck justifiait cette substitution en invoquant le refoulement du premier par le second durablement produit à partir de la culture grecque antique. Il tenait cette opération pour responsable d’un nihilisme occidental destructeur des croyances. Il pensait vital pour un peuple de l’inscrire dans un récit mythique fondateur et unificateur, alors que l’esprit d’examen, la pensée dialectique, et la pratique du doute ne pouvaient que le fragiliser.
Krieck affirmait par ailleurs : « Une éducation atteindra son but, qui est de former et de façonner l’homme, dans la mesure où elle le rendra malléable et plastique. » Et : « La plasticité est changeante, susceptible de s’accroître, si, en émouvant l’homme en son tréfonds, on le dilate, on le soulève, on le fait vibrer, augmentant ainsi sa capacité d’assimilation, sa réceptivité et sa malléabilité. » On pressent dès lors à quelle fonction le sport, l’art et l’esthétique pourront être assignés et comment la jeunesse pourra être incarcérée dans un processus de dressage, et nullement d’éducation réelle, ni d’instruction véritable. On est proche de la haine de la raison, du mépris d’un certain nombre de sciences, sociales plutôt, de la tentation de brûler des livres.Il s’agit bien de privilégier un récit mythique et mystificateur, qui demeure en-deçà du travail de la distinction du « vrai et du non vrai », dans une dynamique qui, s’insurgeant contre une supposée tyrannie du logos, régresse vers un état de pré-vérité (ce qui caractériserait aussi bien ce que nous nommons post-vérité). On comprend comment une telle vision des choses ouvre nécessairement sur un pur rapport de force entre les croyances et les points de vue. La « vérité » est entre les mains du plus fort. Nul besoin d’insister ici sur les analogies entre le monde de Krieck et l’histoire contemporaine
L’Ecole : un lieu de résistance face aux despotismes
L’opposition est maximale entre le despotisme et le républicanisme. Les despotismes détruisent l’espace public, interdisent de penser, forcent au tout ou rien. Aujourd’hui l’état du monde est largement pris dans les violences despotiques de toute nature, pour beaucoup d’une absurdité criminelle, lorsqu’on voit par exemple, dans tel pays, les attaques dirigées contre une recherche scientifique étranglée, dépouillée de ses ressources, dans tel autre une militarisation de l’économie et de l’industrie mensongèrement justifiée par une représentation de l’histoire complètement mystifiée. On compte aujourd’hui à peu près 30% de démocraties dans le monde. Les poussées et les avancées autoritaires et fascisantes sont en Europe même, bien perceptibles. Redisons-le : elles menacent la démocratie et l’esprit républicain. Elles rencontrent un désir d’ordre imprudemment confondu avec la tentation de la soumission, au mépris d’un rigoureux effort de réflexion et de pensée. Si des régimes basculent, du fait même d’un vote, ne faut-il pas voir là une signification à la fois inattendue et vertigineuse de l’« échec scolaire » ?
Il faut relire le chapitre 6 de la 4ème partie de La démocratie en Amérique (1835-1840) : « Quelle espèce de despotisme les nations démocratiques ont à craindre ». Décrivant ce que pourrait être la lente et inexorable emprise d’un « pouvoir immense et tutélaire », d’une instance étatique des temps modernes sur les hommes, Tocqueville écrit : « que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre ? » No comment…
Gildas Labey, novembre 2025
Photos extraites du blog dédié au musée de l'Ecole à Montceau-les-Mines

