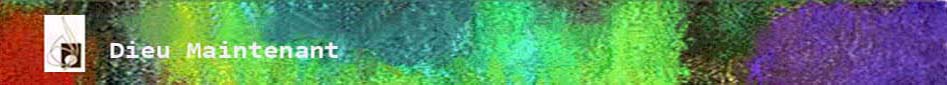

Espérer l'impossible
Dominique Collin
Dominique Collin a soutenu une thèse, au croisement entre philosophie et théologie, sur la foi chrétienne à partir de la pensée de Kierkegaard. Dans la conférence, dont nous reproduisons des extraits, il rend son travail accessible à un large public. Il déclare : « Kierkegaard n’a jamais trouvé meilleur adversaire de l’Évangile que les chrétiens eux-mêmes. (...) Le problème est que l’Évangile n’est pas proclamé comme Évangile mais comme ce qu’il n’est pas : une doctrine et une morale. Si donc vous le transmettez comme tels, il ne faut pas s’étonner que cela tombe progressivement et rapidement sous le coup de l’insignifiance. »
On trouve l'intégralité de cette conférence, donnée en 2020, en cliquant sur ce lien : Espérer l’impossible. Dominique Collin était alors dominicain, il a quitté cet ordre depuis. Il est l'auteur de nombreux livres dont : Le christianisme n'existe pas encore, Ed. Salvator 2018 - L'Evangile inouï, Ed. Salvator 2019 - Mettre sa vie en paraboles (préface de Maurice Bellet), Ed. Fidélité 2010
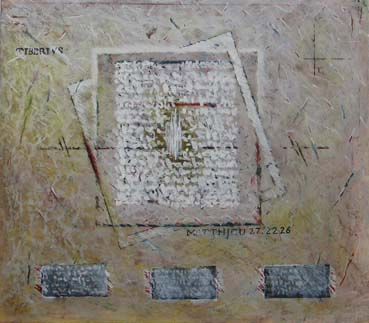
« La parole chrétienne est entrée dans l’insignifiance »
Si je devais vous dire en quelque mots quel a été mon projet en travaillant Kierkegaard, je le tirerais d’une phrase au début du Psaume 115 : « Je crois et je parlerai. » Je crois : mais que signifie je et que signifie croire ? – et je parlerai : comme si du croire ne pouvait venir d’emblée qu’un langage. Croire, c’est parler. Mais parler pour dire quoi ? Parler, mais comment ? Kierkegaard m’a permis de réfléchir au destin actuel – le nôtre – de la parole chrétienne.
Nous ne sommes plus dans une chrétienté. Nous sommes, disent les sociologues, dans un âge post chrétien. Mais il faudrait, à mon sens, mieux dire que nous sommes dans un monde qui est maintenant majoritairement rempli « d’inchrétiens ». Je tire cette expression d’un grand auteur qui a dit cela il y a un siècle et qui s’appelle Charles Péguy. Il désigne par-là, non plus des gens qui sont encore de tradition chrétienne - même s’ils vivent sur les marges - mais des gens qui ont pris leurs distances avec le christianisme, des hommes et des femmes qui n’ont plus rien à voir avec le monde, l’univers ou le sens chrétien. Péguy annonçait déjà que nous en serions là. Pour Kierkegaard, la question de l’entrée progressive du christianisme dans l’insignifiance était déjà prophétisée abondamment. Pour le dire autrement, le plus grand des malheurs du christianisme n’est pas qu’il soit attaqué, c’est qu’il ne le soit plus. Ce n’est pas qu’on ait encore je ne sais quelle crise d’urticaire contre l’institution, contre les Églises, contre le pape quand il était moins sympathiquement et médiatiquement formaté que le nôtre. Aujourd’hui, c’est que cela ne parle plus à personne. Le monde des inchrétiens est notre monde.
La question de Kierkegaard est : si la parole chrétienne est entrée dans l’insignifiance, est-ce parce que la parole d’Évangile n’a pas de « significativité » ou bien est-ce parce que nous ne proclamons pas l’Évangile comme Évangile ? Ou bien c’est l’Évangile lui-même qui est insignifiant et il faudrait en tirer les conclusions qui s’imposent. S’il est lui-même insignifiant, qu’il y eut un jour des chrétiens repose sur le fait qu’une institution avait le pouvoir coercitif de vous faire croire et de vous empêcher de sortir des Églises. Maintenant l’institution ecclésiale n’a plus aucun moyen de vous empêcher de quitter le christianisme. Ou bien, autre branche de l’alternative, la parole Évangile est significative encore faut-il proclamer l’Évangile comme Évangile. C’est là encore que Kierkegaard nous est utile. Il disait, le problème est que l’Évangile n’est pas proclamé comme Évangile mais comme ce qu’il n’est pas : une doctrine et une morale. Si donc vous le transmettez comme tels, il ne faut pas s’étonner que cela tombe progressivement et rapidement sous le coup de l’insignifiance. Si vous dites que l’Évangile est un catalogue de croyances ou de normes morales vous ne proclamez plus l’Évangile comme Évangile.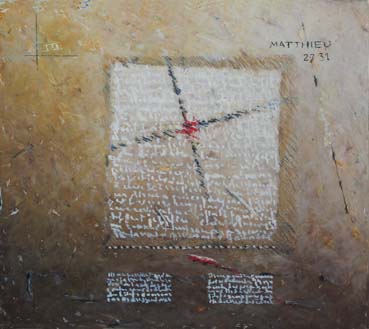
« L’Évangile n’est ni vie de Jésus, ni corps de doctrine ou catalogue de croyances. »
Mais alors qu’est-ce que l’Évangile ? En fait, nous chrétiens, nous ne le savons pas. Si je voulais – à la manière d’un bon catéchiste – vous dire ce qu’est l’Évangile, je me baserais sur son étymologie qui signifie bonne nouvelle. En disant cela, il n’y a plus grande chose à ajouter mais vous savez cette chose. Pour autant, je me demande si nous entendons en quoi la nouvelle nous dit du neuf et en quoi cette nouveauté est - peut-être de toutes les nouvelles – une nouvelle absolument bonne. En quoi notre rapport singulier et collectif de chrétiens à l’Évangile, nous permet de reconnaître qu’il est une nouveauté qui déclasse les nouvelles dont on peut s’abreuver en regardant la télé ou internet… puisque vous savez que les informations – dites les actualités – ne font que recycler de l’ancien : c’est toujours la même histoire, de violences, de jalousies, de successions d’héritages, etc.
Rien que poser la question, un peu rhétorique, en ces termes nous montre que nous ne savons pas très bien ce qu’est l’Évangile. Et comme nous ne le savons pas très bien, pour nous l’Évangile c’est l’histoire de Jésus. Eh bien, pour Kierkegaard c’est une impasse majeure dans laquelle nous tombons tous lourdement et qui fait que nous cherchons à augmenter notre curiosité au lieu d’augmenter notre foi. C’est notre curiosité que nous cherchons à alimenter en lisant les Évangiles parce que c’est l’homme Jésus qui nous intéresse. Or ils ne sont pas très diserts sur les aspects que nous aurions aimé savoir : quel était son âge quand il est mort et non pas 33 ans comme on le croit, quelle était sa taille, quel était son tempérament psychologique ? Faute de trouver ces réponses à notre curiosité, nous aimerions au moins savoir si ce qu’on nous raconte dans les Évangiles est vrai. Mais cette recherche de vérité est celle qui ne nous donnera jamais la vérité de l’Évangile. Kierkegaard avait vu que le christianisme - au début du XIXe siècle, parce qu’il y a l’émergence des sciences historiques – entrait dans une ère dont il ne sortirait pas et qui rendrait sa parole aussi insignifiante que toutes les autres. En effet, comme l’Évangile n’a pas été écrit pour être une vie de Jésus, chaque fois que nous le lisons ainsi nous sommes à côté de la plaque.
L’Évangile n’est ni vie de Jésus, ni corps de doctrine ou catalogue de croyances. Il n’est pas davantage un corps de morale. Parce que là encore, on va chercher dans l’Évangile des préceptes. Et on trouve quoi ? Des paradoxes. On cherche des préceptes et on trouve « si on veut te prendre ton manteau, donne ta tunique », ou « heureux ceux qui pleurent ». On trouve - et là c’est le comble du paradoxe qui fait éclater tout précepte moral - « aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous font du mal, bénissez-les ». Aucune morale n’a jamais pu et n’a jamais été établie sur le précepte de l’amour de l’ennemi. (…) L’Évangile par cette démesure, par cette sortie du précepte et de la norme, nous fait sortir des représentations religieuses pour nous faire voir un autre Dieu, c’est-à-dire un Dieu que nous n’aurions jamais pu inventer si nous en avions eu les moyens. Et en retour, la manière dont l’Évangile parle de Dieu montre un visage de l’être humain que je ne pourrais pas me forger, dans les limites de l’humanisme, de l’anthropologie ou de la nature humaine.
« Le message de l’Évangile est folie et scandale. »
« Je suis qui je suis » c’est la parole adressée à Moïse au Sinaï, la seule interview que nous ayons de Dieu. Mais nous sommes dans l’ignorance de qui est Dieu, comme nous sommes dans l’ignorance de qui nous sommes. Cela veut dire que le savoir laisse la place au croire. C’est ce qu’a voulu montrer Kierkegaard. Les vérités des évangiles sont des vérités paradoxales : on ne les entend et on ne les comprend qu’en perdant quelque moyen qu’offre la raison moderne. Il faut entendre ce que Paul lui-même disait dans la première épitre aux Corinthiens : le message de l’Évangile est folie et scandale. Folie pour ceux qui, comme les Grecs, pensent selon les catégories de la raison, la raison empirique, scientifique, économique, celle qui est à l’œuvre continuellement et absolument dans notre monde. La raison du donnant-donnant, celle qui empêche la reconnaissance et la gratuité, celle qui ne fait pas confiance… Cette raison qui est dominante, eh bien elle doit être non pas abandonnée mais déboussolée, déroutée.
Et c’est ce que Jésus disait ou faisait quand il parlait. Pour preuve, son langage parabolique qui est le lieu exemplaire, dans les Évangiles, d’une logique qui a l’air de commencer familièrement et sur les rails de la raison et qui, subitement, dans le récit de la parabole, fait quitter le vraisemblable pour entrer dans l’invraisemblable. Chaque parabole, chaque béatitude, chaque parole du Christ est un paradoxe qui oblige à faire un détour, à se situer autrement par rapport à la vie, au réel et à soi-même. Pour entendre, il faut des oreilles. Pour voir, il faut des yeux. Mais il s’agit d’entendre et de voir ce qu’on n’avait pas encore bien entendu ni bien vu. De sorte que Kierkegaard, lisant l’Évangile, en redécouvre la valeur inouïe, au sens littéral du terme. L’Évangile c’est de l’inouïe. Mais l’in-ouïe veut dire ce qu’on n’entend pas. Voilà notre difficulté : nous croyons entendre ce qu’est l’Évangile - ce qu’il dit - avec une oreille qui de plus depuis notre prime enfance nous raconte des scènes de la vie de Jésus et nous fait rabâcher des paroles.
Le cœur de sa réflexion - sur ce qu’est l’Évangile et comment il parle - est qu’il y a en tout croyant une oreille qui entend les choses mais qui les entend par rapport à son moi. Quand la parole parle au moi que je suis, c’est-à-dire pour conforter mon assise narcissique, j’entends, je consens et une fois que j’ai compris que cela parle bien de moi, je n’ai plus trop besoin de travailler la chose. Je vais entendre une béatitude – « heureux les pauvres ». Et en plus maintenant nos recherches exégétiques ont fait magiquement que tout le monde – comme si c’était la trouvaille du siècle – va s’emparer de la traduction de Chouraki pour dire que « heureux » signifie « en marche ». Et tout le monde entend l’allant et la dynamique. Mais, bon sang, - quand on entend heureux ceux qui pleurent, heureux les pauvres, heureux ceux qui sont persécutés - s’il suffit de dire qu’il faut entendre en marche pour comprendre la béatitude, c’est qu’on n’a pas encore vraiment entendu. D’une oreille, j’entends ce qui, dans l’Évangile, plaît au moi… ou ne lui plaît pas.
« L’Évangile est radicalement bon et neuf… pour qui l’entend avec ses deux oreilles. »
En plein cœur de l’évangile de Marc au chapitre 8, Jésus demande « qui dites-vous que je suis ? » Pierre répond : « Tu es le Christ ». Jésus ne dit rien mais il ajoute que le Fils de l’Homme va monter à Jérusalem et c’est pour se faire tuer. Pierre entend cela et ça ne lui plait pas. Il ne peut pas entendre un moi qui va vers son suicide et qui y va délibérément. On ne suit jamais un suicidaire. Pierre donc prend à part Jésus et les mots traduisent un violent conflit entre les deux. Jésus est obligé de remettre Pierre à sa place. Littéralement : « Arrière, adversaire, tes vues ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes. » Et puis, ces mots : « S’adressant à la foule, celui qui veut être mon disciple qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Celui qui veut gagner sa vie doit envisager de la perdre, celui qui envisage de perdre sa vie la gagne. »
Si votre moi est contenté quand il entend cela c’est que vous avez d’emblée mis un voile religieux, pieux - que j’appelle la bondieuserie - sur ces mots. Jusqu’à preuve du contraire, il n’y a pas un seul moi sur terre qui veuille se perdre lui-même. Et pourtant Jésus dit que c’est à cette condition qu’on gagne le soi. Perdre son moi en vue de gagner le soi qui est la vie vivante. Qui veut entendre cela ? Et même si j’entends ce qu’il faut entendre, que c’est pour gagner le soi – c’est-à-dire peut-être la seule et véritable bonne nouvelle – il faut que j’entende que cette bonne nouvelle n’est bonne absolument, et d’une nouveauté absolument neuve, qu’à me promettre un soi que je ne suis pas encore mais qui doit passer par la mort du moi.
Ce qui veut dire, je reprends mes deux oreilles : il y a une oreille qui entend l’Évangile comme Évangile – l’appel du soi – et il y a une oreille qui entend la mort du moi. Si vous pouvez entendre de vos deux oreilles que c’est la même bonne nouvelle, vous avez entendu l’Évangile comme Évangile. C’est aussi simple que cela. Donc si vous pouvez entendre de vos deux bonnes oreilles que l’Évangile est radicalement bon et neuf parce qu’il vous dit qu’un soi vivant est votre promesse, c’est-à-dire votre avenir, le moteur de votre espérance tout autant que l’aliment de votre foi et que l’ingrédient de votre amour. – et qu’en même temps vous entendez que la même bonne nouvelle vous dit « ton moi, ça encombre ! Un moi c’est littéralement l’encombrant ! ». Ça encombre sa propre vie et celle des autres. Si vous consentez à vous débarrasser de l’encombrant et que vous entendez que c’est la même bonne nouvelle que de recevoir votre soi, vous avez entendu l’Évangile comme Évangile.
Qu’est-ce que cela signifie concrètement pour la transmission ? Cela veut dire que si vous vous contentez de dire aux gens « il faut mourir à vous-mêmes » vous retournez immédiatement dans un christianisme morbide et mortifère qui, au lieu d’appeler à la vie vivante se complaît de manière perverse avec la mort. Il n’y a aucune dimension ascétique dans l’Évangile comme Évangile. Si l’ascèse est la mort du moi, oui ; mais en vue du soi. D’un autre côté, vous ne pouvez pas faire du christianisme – et c’est le boulevard dans lequel les chrétiens sont entrés – un message de développement personnel du moi. Les progressistes – je n’aime pas ce mot – ont entendu un appel de bonheur dans l’Évangile et ils ont bien fait de l’entendre. Mais ils ont cru que c’était le bonheur promis pour le moi et, en ce sens, ils n’ont pas entendu l’Évangile comme Évangile. Donc ils nous servent un christianisme humaniste, ou un discours des valeurs, ou un discours de la croissance du moi. Mais ce n’est pas la croissance du moi mais l’advenue du soi que dit l’Évangile. Vous pouvez donc flatter les gens tant que vous voulez, vous n’aurez fait qu’ajouter du narcissisme à une société qui en est déjà malade. L’Évangile comme Évangile dit l’advenue du soi, passant par la mort du moi. Et si vous êtes étonnés de ce que je viens d’exprimer, sachez que c’est seulement ce qu’on appelle le mystère pascal.
Dominique Collin, mise en ligne juin 2025
Chemin de Croix de Dominique Penloup

